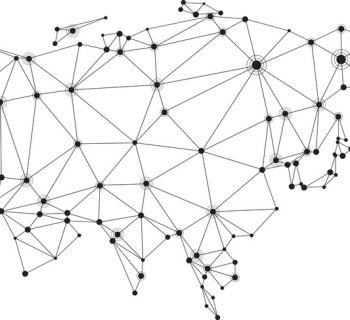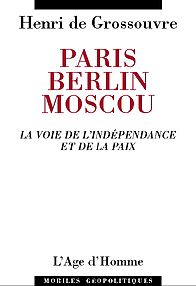- Par Henri de Grossouvre et Richard Kitaeff (Revue Politique et Parlementaire, septembre 2018)
Le fait national – et le risque de sa dislocation dans des entités plus vastes – invite à méditer sur le défi politique crucial de notre époque : l’indépendance de l’Europe. Le monde européen et ses nations ne sont plus, depuis la Deuxième guerre mondiale, sujet mais objet des relations internationales.
Nous assistons, un peu partout dans l’Union européenne, à la montée en puissance de « réactions nationales », qui soulignent à la fois la crise du fait national mais aussi sa persistance. Ce fut le cas récemment en Italie, à propos de laquelle un ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin déclarait, le 22 mai : « Les Italiens ne veulent pas être pauvres et étrangers dans leur pays ». Ou encore quand la Hongrie de Victor Orban embarrasse les instances bruxelloises de l’Europe et multiplie les décisions controversées. Quant au président Macron, il reste ambivalent, entre sa volonté sincère de retrouver une France crédible sur le plan international, sa tentative de restaurer un dialogue avec Poutine depuis la rencontre de Versailles en 2017, et sa promiscuité avec les objectifs non négociables de la globalisation libérale.
Tout cela sur fond d’accusations d’ingérence de la Russie dans les campagnes présidentielles américaine et française, d’annonces fracassantes de Trump en faveur de la Russie (avant et après son élection, et à contre-courant d’un siècle de réflexe des services américains), de l’expulsion d’une centaine d’agents russes sur 14 pays Européens à la grande satisfaction de Theresa May, sans oublier la réunification de la Crimée et cette polémique ukrainienne qui ne s’éteint pas.
Dans ce contexte iconoclaste, prélude vraisemblable à une redistribution des cartes, on considère toujours que le moteur de l’Europe, c’est le moteur franco-allemand. Il y a bien évidemment quelque chose de vrai dans cette idée, mais aussi d’insuffisant sans l’ajout d’une puissance d’ordre continental, démographique et volontariste. Voilà l’idée de « Paris-Berlin-Moscou ».
Or, cette idée a un sens particulier sous la Ve République car il a toujours existé, dans ce régime, une « tradition russe », un courant favorable à des alliances avec la Russie. Charles de Gaulle avait d’ailleurs résumé l’idée en germe dans une conférence de presse tenue au Palais d’Orsay le 29 mars 1949 : « Moi je dis qu’il faut faire l’Europe avec pour base un accord entre Français et Allemands […] Une fois l’Europe faite sur ces bases […], alors, on pourra se tourner vers la Russie. Alors, on pourra essayer, une bonne fois pour toutes, de faire l’Europe tout entière avec la Russie aussi, dut-elle changer son régime. Voilà le programme des vrais Européens. Voilà le mien ».
Par ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, Jean de Boishue, Thierry Mariani, François Fillon, Hubert Védrine…, pour ne prendre que ces quelques exemples, ont des parcours différents mais le point en commun d’avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas en ce qui concerne une certaine « hystérie antirusse »…
- Relancer le « moteur franco-allemand » de l’Europe
La réconciliation de la France et de l’Allemagne, après ce que Ernst Nolte a appelé la « guerre civile européenne », était une obligation incontestable compte tenu des deux conflits mondiaux du XXème siècle. Les conceptions française et allemande de la nation n’en restent pas moins très différentes. Pour le cas allemand, le sentiment national s’est propagé grâce à la culture et la langue et s’est réalisé au XIXe au sein d’un courant libéral progressiste alors que la conception française résumée par Ernest Renan s’appuie sur un vivre-ensemble et un consentement mutuel et éclairé.
Cette différence à la base explique peut-être pourquoi l’Union européenne, basée sur l’alliance franco-allemande mêlant deux faits nationaux pour les extirper de leur scène conflictuelle, ne parvient pas à rassembler toutes les énergies internes de ses nations. Ce hiatus entre les deux conceptions française et allemande de la nation a débordé sur tout le contenu européen et a empêché que l’Union devienne une organisation continentale souveraine suivant ses propres buts.
En tout état de cause, le moteur franco-allemand et le noyau carolingien qu’était l’Europe des six, est un premier pas vers une « Grande Europe », certes, mais incapable à lui seul de mener la marche jusqu’à rivaliser avec les États-Unis d’Amérique, en expansion mondiale depuis l’annexion d’Hawaï en 1898.
Cette équation internationale est à interpréter comme telle. Elle a ruiné, dès son origine, le projet d’une Europe forte et indépendante, parlant avec sa voix à elle. L’Union européenne est comme meurtrie par des récits nationaux qu’elle ne parvient pas à articuler entre eux. Il lui manque cruellement un « roman européen », alors que l’histoire de notre continent est plusieurs fois millénaire, tout comme l’existence de nos peuples. Des mythes d’Homère à l’Union européenne, l’Europe a trébuché et se trouve aujourd’hui dans une aphonie terrible sur le plan politique. Comment pourrait-elle, dans ces conditions, exprimer une volonté précise dans ses relations internationales ?
Il importe pourtant de sauver le fait national en Europe (et ailleurs) ! Autant, le phénomène étatique peut sortir altéré des processus de gouvernance globaux, autant le fait national mérite d’être conservé malgré ces processus.
Seuls les droits de l’homme constituent aujourd’hui un socle de base pour l’Union européenne. Mais ces principes moraux ne permettent pas d’insuffler une originalité intellectuelle et un facteur d’identité par rapport aux États-Unis d’Amérique. Au contraire, les États européens sont contraints de suivre la politique étrangère étasunienne qui sanctionne le non-respect des droits de l’homme toujours en fonction de ses intérêts exclusifs. L’interventionnisme moraliste américain est précédé par un arrière-plan de décisions industrielles et de choix financiers. Le titre « L’Amérique otanise l’Europe », article publié par Michel Deutsch dans Libération du 30 avril 1999, résume bien la situation, la même qu’aujourd’hui !
Vu cette composition des forces et ses déséquilibres structurels, Paris et Berlin pourrait bien avoir, ensemble, une autre utilité que la commémoration historique et l’univers nécessaire mais limité de la réconciliation. Un autre but que la seule croissance économique, comme par exemple élaborer une véritable vision géopolitique européenne. Il s’agirait de proposer une réorientation partielle du franco-allemand vers la Russie pour des raisons à la fois industrielles et culturelles. Cela passerait par un changement de cap dans la politique russe de l’Union européenne.
Le franco-allemand se dote aujourd’hui d’outils nouveaux, comme par exemple le projet JEDI. Ce collectif de 80 grands groupes et organismes de recherche appelle à créer une agence franco-allemande dédiée à l’innovation de rupture, dotée d’un milliard d’euros par an. Son modèle : la Darpa, l’agence de recherche avancée du Pentagone qui est notamment à l’origine de la technologie GPS. Les membres de « Paris Berlin Moscou » travaillent en concertation avec des personnes portant ce projet qui devrait être formalisé le 22 janvier 2019 à l’occasion des 55 ans du traité de l’Elysée. Autre projet pouvant faire l’objet d’une série de mesures nouvelles le 22 janvier prochain : l’ambitieuse Euro-collectivité d’Alsace portée par Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, présidents respectivement des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dans le cadre d’une fusion de ces départements et de la création simultanée d’une nouvelle collectivité française dotée de compétences supplémentaires et d’une nouvelle collectivité européenne franco-allemande.
Relancer le franco-allemand est une exigence industrielle et géopolitique. Mais le problème de base n’est pas encore résolu. Dans la constellation des faits nationaux européens, il manque un chef de file de rang continental, c’est-à-dire une nation plus forte que la somme des autres.
- De Washington à Moscou
Actuellement, dans la réalité diplomatique des chancelleries, l’axe majeur est la relation opérationnelle Paris-Berlin-Washington. Mais la tentation a toujours été présente d’un reclassement des priorités stratégiques, notamment énergétiques, et donc d’une redirection des pratiques institutionnelles vers une meilleure prise en compte de la Russie.
Un déclic a eu lieu le 28 février 1997 quand la Russie est devenue membre du Conseil de l’Europe, 39ème État membre malgré les débats relatifs aux conditions qu’un membre de l’Organisation est tenu de respecter. La Russie a su y trouver sa place. L’effet symbolique de cette adhésion a été de réduire le « tabou russe » dans les institutions européennes et de montrer qu’un chemin vers Moscou était possible, dans un sens puis dans l’autre. Malheureusement, l’évolution du rôle du Conseil de l’Europe n’a pas été à la hauteur de ses nouvelles ambitions d’alors principalement en raison de l’élargissement de l’UE en Europe centrale et orientale. Il n’est pas anodin de rappeler au lendemain du Brexit que nos amis britanniques ont joué à la fois un rôle pour l’élargissement de l’UE car élargir sans approfondir réduisait l’Union à une fonction commerciale dépendante des Etats-Unis mais ils ont aussi contribué à cantonner l’activité du Conseil de l’Europe dans ses missions classiques.
Les trois capitales symboliques de ce chemin ne sont pas exclusives mais emblématiques. Ainsi, cet axe Paris-Berlin-Moscou est indestructible car il repose sur une conception du monde. Seule une intégration vers l’Est constitue l’appel d’air capable de sauver la paix globale et de réorganiser les processus de gouvernance internationale. Il est significatif que deux gaullistes historiques, tous deux anciens Premier ministre et hommes de convictions, tendent vers cette conception nouvelle de l’Europe. C’est ce que proclame Dominique de Villepin quand il en appelle, en mai 2018, pour régler le problème syrien notamment, à un « dialogue structuré entre Paris, Berlin, Moscou et Pékin ». Quand à Jean-Pierre Raffarin, toujours au mois de mai 2018, il préconise de s’appuyer sur un G4 composé de Paris, Berlin, Moscou et Pékin pour sortir de la crise du nucléaire iranien : « Cela veut dire qu'il faut absolument dégager une position commune et un grand accord eurasiatique […] Il faut des idées nouvelles : cette dorsale euro-asiatique, il faut la fonder ».
Les États-Unis assument aujourd’hui avec une brutalité sans précédent la défense de leurs intérêts, comme en témoigne leur nouvel unilatéralisme : sanctions contre la Russie, politique des droits de douane, sortie non négociée de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, menaces de représailles économiques, utilisation de plus en plus fréquente de l'extraterritorialité du droit pénal américain contre les grands groupes européens.
Les identités des nations composant l’Union seront balayées complètement par ce monde américain à moins qu’elles puissent disposer d’un recours géopolitique. Il est clair que la Russie, indépendamment de son image médiatique en France, peut constituer un tel recours afin de rééquilibrer nos relations avec les États-Unis, relancer certains secteurs industriels et restructurer les politiques de solidarité nationale des pays européens. Aussi vrai qu’il y a une Russie européenne et une Russie asiatique, il existe des coopérations eurasiatiques en train de se développer et capables d’assurer la voie de la paix tout en maintenant leurs références culturelles et tissus industriels.
Comme l’écrivait Fernand Braudel, dans Grammaire des civilisations en 1962, « la Russie se tourne de plus en plus vers l’Europe. C’est là, pendant les siècles de sa modernité et jusqu’en 1917 et même au-delà, le fait crucial de son histoire ». De son côté, un demi-siècle plus tard, Vladimir Poutine déclarait au Bundestag le 25 septembre 2001 : « Mais je crois que l’Europe ne peut à long terme affermir sa réputation de puissant et indépendant centre de la politique mondiale seulement si elle unifie ses moyens avec les hommes, le territoire et les ressources naturelles russes ainsi qu’avec le potentiel économique, culturel et de Défense de la Russie ». Voilà les conditions pour que les Européens aient l’ambition de prendre en charge leur sécurité, leur destin, leur avenir et osent à nouveau porter un regard enveloppant et bienveillant sur le monde comme ils l’ont fait pendant des millénaires.
Henri de Grossouvre, fondateur et président d’honneur de « Paris Berlin Moscou »
Richard Kitaeff, président de « Paris Berlin Moscou »